Les acariens

Photo 1 – Tétranyque de l’épinette adulte, Oligonychus ununguis (Jac.).
Les acariens, qui appartiennent au grand groupe des arthropodes, ne sont pas des insectes. Ils n’ont, en effet, ni antennes, ni mandibules, et leur corps, sphérique ou ovale, est non segmenté. Comme ils sont minuscules (de 0,1 mm à 2 mm), les acariens passent souvent inaperçus et ce sont généralement leurs dégâts qui attirent l’attention. Certains d’entre eux endommagent les plantes, d’autres parasitent les insectes et les mammifères, l’homme y compris, et d’autres enfin transmettent des maladies.
Deux groupes importants d’acariens s’en prennent aux arbres et aux arbustes : les tétranyques (photo 1) et les phytoptes (figure 1).
Les tétranyques
Biologie, comportement et dégâts
Les tétranyques traversent quatre stades de développement : l’œuf devient larve, puis nymphe et, enfin, adulte. Globulaires et à peine visibles à l’œil nu, ils ont quatre paires de pattes, à l’âge adulte (photo 1), et seulement trois, au stade larvaire. Ils ressemblent à de très petites araignées et ils possèdent de longs chélicères en forme de stylets. Pendant l’été, ils déposent leurs œufs sur les pousses et les aiguilles, mais à l’approche de la saison froide, ils le font plutôt à la base des aiguilles. Les œufs pondus tardivement passent l’hiver sur leurs hôtes pour éclore au début de juin. Dès qu’ils sont devenus adultes, c’est-à-dire deux ou trois semaines après l’éclosion, les tétranyques commencent à tisser inlassablement leurs toiles (photo 2). Ces petits animaux peuvent se reproduire au rythme de quatre à six générations par année. À l’aide de leurs chélicères, les nymphes et les adultes percent les cellules des feuilles et des aiguilles pour se repaître du suc qu’elles renferment.
Les aiguilles infestées prennent rapidement une coloration marbrée, jaunâtre, puis brunâtre (photo 3). Si l’infestation est grave, elles peuvent tomber prématurément. Les résineux les plus affectés sont les épinettes, mais le sapin (photo 4) et certains autres conifères sont aussi vulnérables aux tétranyques. Plusieurs espèces d’acariens s’en prennent également aux feuillus (photo 5).

Photo 2 – Tétranyque de l’épinette, nymphes et adultes, entourés de leurs toiles et d’œufs.

Photo 3 – Jeune épinette gravement affectée par le tétranyque de l’épinette.

Photo 4 – Aiguilles de sapin infestées de tétranyques de l’épinette.

Photo 5 – Feuilles de chêne décolorées par des tétranyques.
Détection
Quand on voit de petites toiles tissées sur un feuillage devenu jaunâtre ou brunâtre et qui semble sale et terne, on peut soupçonner la présence de tétranyques. Pour le confirmer, il suffit de secouer un rameau suspect au-dessus d’une feuille de papier blanc. Si de petits points rouges tombent sur la feuille, l’arbre est infesté.
Lutte
Dans les petites plantations et sur les arbres d’ornementation, on peut lutter contre les tétranyques en arrosant copieusement le feuillage des plantes attaquées avec un fort jet d’eau. On détruit ainsi les toiles et on déloge une partie de la population. Ce traitement augmente aussi le taux d’humidité, ce qui freine le développement des acariens. Dans les cas graves, on peut être forcé d’avoir recours à un acaricide.
Les phytoptes
Biologie, comportement
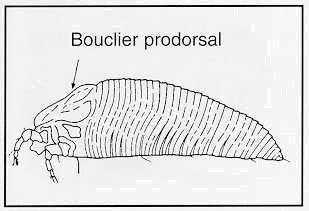
Figure 1 – Allure générale d’un phytopte.
Les phytoptes sont beaucoup plus répandus que les tétranyques. Les espèces qui font des ravages sont essentiellement gallicoles. Elles provoquent la formation de tumeurs, galles ou cloques qui déforment les tissus des plantes. La forme des tumeurs varie selon l’espèce d’acariens en cause.
Les phytoptes connaissent trois stades de développement : œufs, larve et adulte. Invisibles à l’œil nu (de 0,1 mm à 0,5 mm), les adultes ont un corps allongé, muni de deux paires de pattes (figure 1).
Les phytoptes passent l’hiver au stade adulte et reprennent leurs activités au printemps. Ils s’alimentent et pondent dans les tissus de la plante, y provoquant ainsi la formation de galles dans lesquelles leurs larves se développent. Ils se reproduisent habituellement au rythme de quatre générations par année.
Contrairement aux tétranyques, les phytoptes s’attaquent surtout aux feuillus. Leurs hôtes préférés sont l’érable (photos 6 à 8), le bouleau, le frêne (photo 9), le tilleul, l’orme (photo 10) et l’aulne. Néanmoins, ils s’en prennent parfois au genévrier, un conifère.

Photo 6 – Galles attribuables au phytopte vésiculaire de l’érable, Vasates quadripedes Shimer, sur les feuilles d’un érable argenté.

Photo 7 – Galles provoquées par le phytopte fusiforme de l’érable, Vasates aceris-crumena aceriscrumena (Riley & Vasey), sur des feuilles d’érable à sucre.

Photo 8 – Galles microscopiques sur une feuille d’érable à sucre qui révèlent la présence du phytopte veloutant de l’érable, Aceria elongatus (Hodg.).
Détection
La présence des phytoptes est révélée par les déformations ou renflements qu’ils font naître sur les feuilles, les rameaux, les bourgeons ou les fleurs (photo 9) de leurs hôtes.
On les détecte également par les galles ou cécidies qu’il provoquent sur le limbe des feuilles. En fait, ils attirent souvent l’attention en provoquant l’apparition d’une multitude de petites galles microscopiques, très colorées, qui forment une sorte de tapis velouté (photos 8 et 10).

Photo 9 – Grosses galles provoquées par le phytopte des fleurs du frêne, Aceria fraxiniflora (Felt), sur les fleurs mâles d’un frêne.

Photo 10 – Feuilles d’orme infestées de phytoptes veloutants.
Dégâts
Les dommages causés par les phytoptes sont généralement insignifiants sur les arbres déjà bien établis.Seule l’apparence de leurs hôtes est altérée.
Lutte
Comme les acariens ne causent pas de dégâts graves, on recommande de ne pas leur faire la lutte, sauf dans les cas exceptionnels, où il peut être nécessaire d’appliquer une huile dormante très tôt le printemps, avant l’ouverture des bourgeons.