Suivis forestiers des traitements sylvicoles réalisés au Québec et rentabilité des investissements
Le Ministère est responsable du suivi et du contrôle des interventions en forêt publique au Québec. Ainsi, il vérifie la qualité des traitements sylvicoles effectués ainsi que l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du processus de planification forestière.
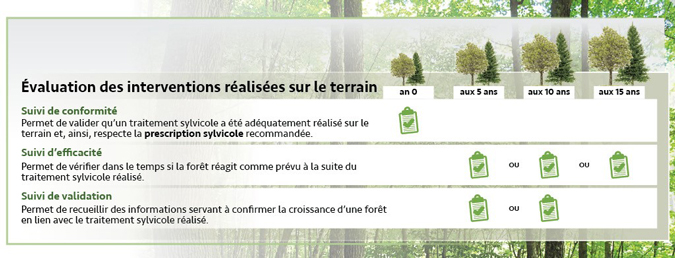
Pour en apprendre plus à ce sujet
- Feuillet Comment le Ministère s’assure-t-il que les arbres repoussent et se développent?

- Suivis forestiers des traitements sylvicoles réalisés au Québec et rentabilité des investissements

Reddition de comptes de la saison 2020-2021
Suivis d’efficacité
| Intervention à suivre | Objectif | Niveau de réalisation des suivis1 | Atteinte des critères de régénération2 |
|---|---|---|---|
| Coupe totale | Confirmer la mise en place de la régénération 5 ans après la récolte (10 ans dans le cas de gradient de sylviculture extensif) |
64 % La reddition de comptes de cette période porte sur le suivi de la régénération des interventions réalisées au cours de la saison 2015-2016, ce qui représente environ 55 000 ha. |
84 % des superficies suivies atteignent les critères de mise en place de régénération5. |
| Coupe partielle avec objectif d’établissement de régénération en essences désirées | Confirmer la mise en place de la régénération 5 ans après la dernière intervention de régénération |
51 % La reddition de comptes de cette période porte sur le suivi des interventions réalisées au cours de la saison 2015-2016. Plus de 16 000 ha de ces interventions ont fait l’objet d’un suivi4. |
91 % des superficies suivies atteignent les critères de régénération5. |
| Intervention de régénération artificielle (plantation, regarni) | Confirmer l’état de la régénération 15 ans après l’intervention de régénération artificielle3 |
76 % La reddition de comptes de cette période porte sur le suivi des interventions réalisées au cours de la saison 2005-2006. Plus de 35 000 ha de ces interventions ont fait l’objet d’un suivi4. |
87 % des superficies suivies atteignent les critères de régénération5. |
1 Le niveau de réalisation des suivis représente les superficies qui ont fait l’objet d’un suivi, c’est-à-dire les superficies pour lesquelles une évaluation de l’atteinte des objectifs a été effectuée, par rapport aux superficies qui auraient dû faire l’objet d’un suivi selon le calendrier de suivi défini.
2 L’atteinte des critères de régénération représente le pourcentage d’atteinte des objectifs définis provincialement pour la régénération, soit principalement de confirmer la mise en place des conditions de croissance désirées (capacité des arbres à croître librement, leur répartition et leur hauteur).
3 Ces interventions de régénération artificielle ont déjà fait l’objet d’un suivi 5 ans après la dernière intervention pour confirmer la mise en place de la régénération. De plus, outre les suivis nécessaires pour répondre aux indicateurs provinciaux, les régions peuvent établir d’autres suivis à divers moments, notamment selon l’abondance d’espèces compétitrices, afin de confirmer le maintien du scénario sylvicole et la réalisation des traitements sylvicoles prévus.
4Par souci d’optimiser le travail sur le terrain, certains secteurs d’intervention sont privilégiés puisqu’ils regroupent des superficies à proximité, dont les délais de suivi et la méthodologie d’inventaire sont semblables. Le suivi peut donc être devancé ou retardé.
Les efforts en matière de suivis sont établis a priori lors de la planification forestière, sur la base du type d’intervention réalisé, de son gradient d’intensité du scénario sylvicole et des investissements sylvicoles qui y sont associés. L’optimisation des nouvelles méthodes d’inventaire, notamment à l’aide d’imagerie numérique, permettra d’accroître le niveau de réalisation des suivis d’efficacité au cours des prochaines années. Dans les dernières années, le Ministère a créé une base de données qui facilite la localisation des superficies à suivre, permet une mise à jour optimale des intrants nécessaires à une bonne gestion des informations et contribue à une reddition de comptes adéquate et rigoureuse. Les niveaux de réalisation d’une saison donnée évoluent donc à mesure que les informations sont disponibles.
5 Une atteinte incomplète des critères de mise en place et de l’état de la régénération au moment des inventaires ne signifie pas l’échec du traitement sylvicole réalisé. Les résultats des suivis visent d’ailleurs à détecter certains problèmes et pallier un manque de régénération ou cerner les besoins d’entretien de plantation. Les résultats des suivis permettent de prescrire et de réaliser les traitements sylvicoles nécessaires pour l’atteinte des objectifs sylvicoles et des stratégies d’aménagement préétablies.
Sommes investies pour les travaux sylvicoles
Pour l’exercice financier 2020-2021, le Ministère avait prévu un budget de base de 230 M$ pour la réalisation des travaux sylvicoles en forêt publique, ainsi que pour le financement de différents programmes qui concourent à l’aménagement durable des forêts, dont l’acquisition de connaissances et l’éducation forestière.
En plus, deux autres mesures, soit le Plan d’action sur les changements climatiques (3,9 M$) financé par le Fonds vert et le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone (7,1 M$), qui ont comme objectif la lutte contre les changements climatiques, s’ajoutent au budget pour la réalisation des travaux sylvicoles.
Ainsi, un budget total de 241 M$ était disponible pour la réalisation des travaux sylvicoles en forêt publique pour l’exercice financier 2020-2021. Les investissements dans la réalisation des travaux sylvicoles permettent la mise en œuvre des stratégies régionales d’aménagement forestier et soutiennent le développement économique du Québec.
Les activités prévues dans le budget de réalisation des travaux sylvicoles comprennent l’exécution des travaux sylvicoles non commerciaux (préparation de site, reboisement, dégagement et éclaircie précommerciale), des travaux commerciaux (récolte forestière) et les activités connexes essentielles à la réalisation des travaux sylvicoles (inventaires d’intervention et après-traitement, martelage, entretien de chemin, etc.).
Tableau des investissements pour la réalisation des travaux sylvicoles en fonction du budget prévu – Exercice financier 2020-2021
| Source de financement | Budget 2020-2021 ($) |
Investissements réalisés 2020-2021 ($) |
|---|---|---|
| Programme régulier – Travaux sylvicoles non commerciaux (TSNC) | 174 936 000 | 170 322 269 |
| Programme Régulier – Travaux sylvicoles commerciaux (TSC) (inclus Programme d’investissement en aménagement forestier, les plans spéciaux, la Paix des braves) | 39 268 000 | 39 938 804 |
| Autres (martelage, planification forestière, promotion et sensibilisation forestières, recherche et développement) | 15 796 000 | 15 242 437 |
| Total pour le Programme régulier | 230 000 000 | 225 503 510 |
| Plan d’action sur les changements climatiques (PACC) | 3 851 928 | 3 982 792 |
| Fonds du leadership | 7 121 000 | 7 121 000 |
| Grand total |
Au cours de l’exercice financier 2020-2021, un total de 236,6 M$ a été investi dans la réalisation des travaux sylvicoles, auquel s’ajoute une dépense de 10,6 M$ pour couvrir les frais supplémentaires liés aux mesures sanitaires, pour un total général de 247,2 M$.
Reddition de comptes de la saison 2019-2020
Suivis d’efficacité
| Intervention à suivre | Objectif | Niveau de réalisation des suivis6 | Atteinte des critères de régénération7 |
|---|---|---|---|
| Coupe totale | Confirmer la mise en place de la régénération 5 ans après la récolte (10 ans dans le cas de gradient de sylviculture extensif) |
82 % La reddition de comptes de cette période porte sur le suivi de la régénération des interventions réalisées au cours de la saison 2014-2015, ce qui représente environ 58 000 ha. |
88 % des superficies suivies atteignent les critères de mise en place de régénération10. |
| Coupe partielle avec objectif d’établissement de régénération en essences désirées | Confirmer la mise en place de la régénération 5 ans après la dernière intervention de régénération |
56 % La reddition de comptes de cette période porte sur le suivi des interventions réalisées au cours de la saison 2014-2015. Plus de 15 000 ha de ces interventions ont fait l’objet d’un suivi9. |
57 % des superficies suivies atteignent les critères de régénération10. |
| Intervention de régénération artificielle (plantation, regarni) | Confirmer l’état de la régénération 15 ans après l’intervention de régénération artificielle8 |
72 % La reddition de comptes de cette période porte sur le suivi des interventions réalisées au cours de la saison 2004-2005. Plus de 30 000 ha de ces interventions ont fait l’objet d’un suivi9. |
71 % des superficies suivies atteignent les critères de régénération10. |
6 Le niveau de réalisation des suivis représente les superficies qui ont fait l’objet d’un suivi, c’est-à-dire les superficies pour lesquelles une évaluation de l’atteinte des objectifs a été effectuée, par rapport aux superficies qui auraient dû faire l’objet d’un suivi selon le calendrier de suivi défini.
7 L’atteinte des critères de régénération représente le pourcentage d’atteinte des objectifs définis provincialement pour la régénération, soit principalement de confirmer la mise en place des conditions de croissance désirées (capacité des arbres à croître librement, leur répartition et leur hauteur).
8 Ces interventions de régénération artificielle ont déjà fait l’objet d’un suivi 5 ans après la dernière intervention pour confirmer la mise en place de la régénération. De plus, outre les suivis nécessaires pour répondre aux indicateurs provinciaux, les régions peuvent établir d’autres suivis à divers moments, notamment selon l’abondance d’espèces compétitrices, afin de confirmer le maintien du scénario sylvicole et la réalisation des traitements sylvicoles prévus.
9 Par souci d’optimiser le travail sur le terrain, certains secteurs d’intervention sont privilégiés puisqu’ils regroupent des superficies à proximité, dont les délais de suivi et la méthodologie d’inventaire sont semblables. Le suivi peut donc être devancé ou retardé.
Les efforts en matière de suivis sont établis a priori lors de la planification forestière, sur la base du type d’intervention réalisé, de son gradient d’intensité du scénario sylvicole, et des investissements sylvicoles associés. L’optimisation des nouvelles méthodes d’inventaire, notamment à l’aide d’imagerie numérique, permettra d’accroître le niveau de réalisation des suivis d’efficacité au cours des prochaines années. Depuis 2018, le Ministère développe une base de données provinciale qui, à terme, facilitera la localisation des superficies à suivre, permettra une mise à jour optimale des intrants nécessaire à une bonne gestion des informations et contribuera à une reddition de comptes adéquate et rigoureuse. Les niveaux de réalisation d’une saison donnée évolueront donc à mesure que les informations seront disponibles.
10 Une atteinte incomplète des critères de mise en place et d’état de la régénération au moment des inventaires ne signifie pas l’échec du traitement sylvicole réalisé. Les résultats des suivis visent d’ailleurs à détecter certains problèmes et pallier un manque de régénération ou cerner les besoins d’entretien de plantation. Les résultats des suivis permettront de prescrire et réaliser les traitements sylvicoles nécessaires pour l’atteinte des objectifs sylvicoles et des stratégies d’aménagement préétablies.
Sommes investies pour les travaux sylvicoles
Pour l’exercice financier 2019-2020, le Ministère avait prévu un budget de base de 230 M$ pour la réalisation des travaux sylvicoles en forêt publique, ainsi que pour le financement de différents programmes qui concourent à l’aménagement durable des forêts, dont l’acquisition de connaissances et l’éducation forestière.
En plus, deux autres mesures, soit le Plan d’action sur les changements climatiques (1,3 M$) financé par le Fonds vert et le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone (4,2 M$), qui ont comme objectif la lutte contre les changements climatiques, s’ajoutent au budget pour la réalisation des travaux sylvicoles.
Ainsi, un budget total de 235,5 M$ était disponible pour la réalisation des travaux sylvicoles en forêt publique pour l’exercice financier 2019-2020. Les investissements pour la réalisation des travaux sylvicoles permettent la mise en œuvre des stratégies régionales d’aménagement forestier et soutiennent le développement économique du Québec.
Les activités prévues dans le budget de réalisation des travaux sylvicoles comprennent l’exécution des travaux sylvicoles non commerciaux (préparation de site, reboisement, dégagement et éclaircie précommerciale), des travaux commerciaux (récolte forestière) et les activités connexes essentielles à la réalisation des travaux sylvicoles (inventaires d’intervention et après-traitement, martelage, entretien de chemin, etc.).
Tableau des investissements pour la réalisation des travaux sylvicoles en fonction du budget prévu – Exercice financier 2019-2020
| Source de financement | Budget 2019-2020 ($) |
Investissements réalisés 2019-2020 ($) |
|---|---|---|
| Programme régulier – Travaux sylvicoles non commerciaux (TSNC) | 177 730 000 | 182 433 592 |
| Programme Régulier – Travaux sylvicoles commerciaux (TSC) (inclus Programme d’investissement en aménagement forestier, les plans spéciaux, la Paix des braves) | 39 185 000 | 39 583 155 |
| Autres (martelage, planification forestière, promotion et sensibilisation forestières, recherche et développement) | 13 085 000 | 13 450 839 |
| Total pour le Programme régulier | 230 000 000 | |
| Plan d’action sur les changements climatiques (PACC) | 1 292 897 | 1 756 504 |
| Fonds du leadership | 4 210 000 | 4 281 295 |
| Grand total |
Au cours de l’exercice financier 2019-2020, un total de 241,5 M$ ont été investis pour la réalisation des travaux sylvicoles. Les investissements ont dépassé légèrement le budget prévu afin de réaliser certains travaux sylvicoles préalables aux travaux à exécuter pour la saison d’activité 2020-2021. Ces investissements ont été devancés du budget 2020-2021. Par ailleurs, les montants en surplus investis en provenance du Plan d’action sur les changements climatiques et du Fonds du leadership ont été réalisés à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire globale de ces mesures budgétaires.
Rentabilité économique des investissements sylvicoles
Depuis une dizaine d’années, le Ministère a déployé plusieurs outils afin d’optimiser la rentabilité économique des investissements sylvicoles. La rentabilité économique des investissements est établie par la différence obtenue entre les revenus et les coûts générés pour la société. Dans le calcul, on tient compte des revenus des travailleurs dans les entreprises de sylviculture, de récolte et de transformation du bois. On inclut également les bénéfices de ces trois types d’entreprises ainsi que les redevances forestières versées au gouvernement du Québec. Les coûts d’approvisionnement et de transformation du bois et ceux associés aux travaux sylvicoles sont aussi considérés. L’analyse de rentabilité économique consiste donc à comparer la création de richesse générée par un investissement sylvicole à celle générée par la production naturelle de la forêt.
À cet effet, des analyses réalisées par le Ministère ont permis d’inclure la rentabilité des investissements sylvicoles dans les décisions liées à l’aménagement forestier régional. Elles confirment également que les investissements sylvicoles sont rentables. La rentabilité économique des investissements sylvicoles repose sur leur capacité à accroître les volumes et la qualité de la récolte future. Les revenus que tire l’État aujourd’hui de la forêt ne peuvent pas être associés aux sommes investies actuellement. En effet, une forêt prend plusieurs décennies avant d’arriver à maturité et d’être récoltée. C’est donc dans plusieurs décennies que l’État capitalisera les investissements réalisés aujourd’hui. Ainsi, la forêt publique génère actuellement des revenus économiques moyens pour la société de 36 $/m3, revenus qui proviennent notamment des sommes investies dans la forêt au cours des dernières décennies. En effet, chaque dollar investi rapporte en moyenne 1,35 $ en dollars d’aujourd’hui.
Pour en apprendre plus à ce sujet, consultez le Rapport d’analyses sur la rentabilité économique des investissements sylvicoles ![]() .
.